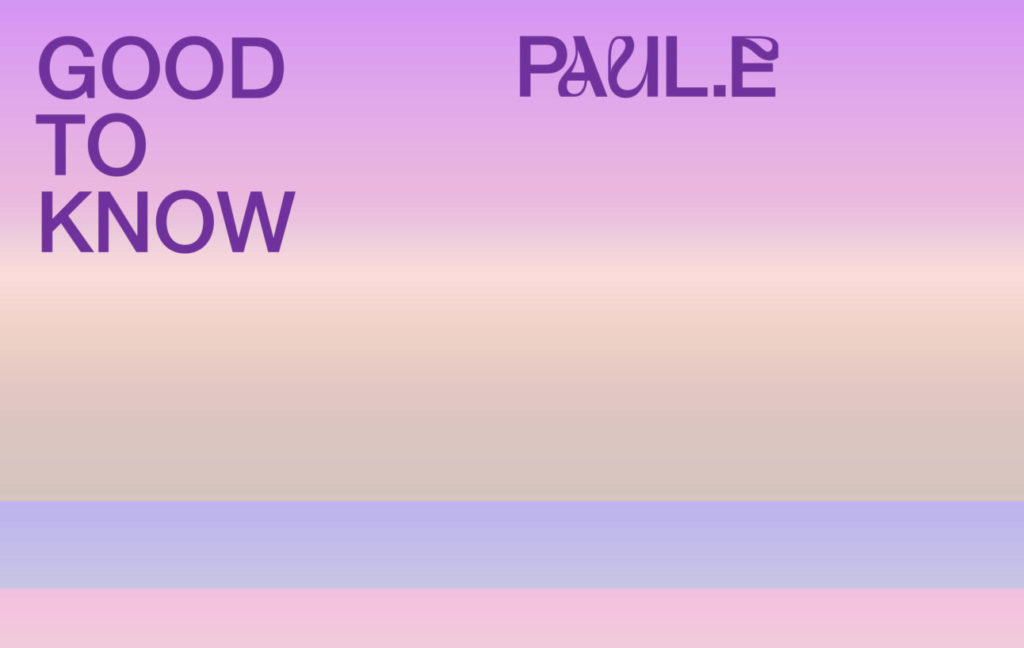Parce que l’égalité passe aussi par la langue, on décrypte ce qui rend l’écriture inclusive indispensable
L’écriture inclusive repose sur plusieurs grands principes : féminiser les fonctions, les métiers et les grades, refuser que le masculin l’emporte sur le féminin au pluriel, utiliser un point médian pour éviter les doublets, ou encore troquer les expressions inutilement genrées pour des mots épicènes (exemple : les « droits humains » plutôt que les « droits de l’Homme »). Un outil de lutte nécessaire à une société égalitaire, que l’Académie française qualifie sobrement de « péril mortel ». Pourquoi tant de haine ? Chez Paul.e, en tout cas, on a décidé de défendre l’écriture inclusive jusque dans notre titre.

Dire que le sujet divise est un doux euphémisme. L’écriture inclusive, son « terrible » point médian et les suffixes de féminisation (« euse », « eure », « esse » ou « trice ») semblent être devenus, pour les plus fervent·es opposant·es, le symbole d’une France menaçante. Une France qui se rebelle, qui demande des comptes, qui exige que sa langue soit le reflet de ses combats pour l’égalité, quand certain·es souhaitent plutôt s’accrocher à une grammaire enseignée depuis 300 ans comme au rempart d’un monde archaïque qui s’effrite.
À l’instar des questions écologiques, féministes, anti-racistes, LGBTQIA+, le thème visiblement clivant a été intégré à la grosse marmite du « wokisme », que celleux qui n’y comprennent pas grand-chose brandissent comme une expression insultante. À les écouter, l’écriture inclusive serait « nuisible à la pratique et à l’intelligibilité de la langue française », statuait une circulaire du ministère de l’Éducation nationale datée du 6 mai 2021 qui en proscrit l’usage. Pourtant, c’est là que ses détracteur·rices se trompent : questionner le français n’est pas le menacer, protéger la sacro-sainte « langue de Molière » n’est pas non plus la rendre immuable.
« J’ai du mal à comprendre comment on peut refuser de voir la langue comme quelque chose qui soit en mouvement, qui soit support de réflexion, nous confie par téléphone Françoise Cahen, doctoresse agrégée de lettres modernes enseignant au lycée Maximilien Perret d’Alfortville, au sujet des positions du ministère et de certain·es de ses consœurs et confrères. C’est même [la] respecter que de la considérer comme vectrice de valeurs. » Et quelles valeurs ! Prôner l’égalité, dénoncer la supériorité masculine clairement inscrite dans nos lignes, bâtir un monde, sur le papier et au-delà, où chacun·e est (enfin) visible. Inclure, donc, plutôt qu’exclure, et revenir sur des siècles de discrimination assumée.
« Une question de justice et de justesse »
« La langue française telle qu’elle est pratiquée reflète le sexisme qui existe dans nos esprits », nous confirme Éliane Viennot,historienne et professeuse (elle insiste sur le terme) à l’université Jean-Monnet de Saint-Étienne. L’emblème ultime de ce sexisme ? Une règle qu’on apprend dès nos 7 ans, et qui révèle à qui aurait réussi à l’ignorer comment fonctionne le patriarcat depuis la nuit des temps : « le masculin l’emporte sur le féminin ». Ces quelques mots, et leurs conséquences « traumatisantes », pour les enfants et les adultes qu’iels deviendront plus tard, ont été rendu·es obligatoires au xviie siècle. Pas avant. Non, avant, « la société était déjà sexiste, précise Éliane Viennot, mais d’autres types d’accords se pratiquaient aussi ». Celui de proximité, qui implique qu’on accorde un adjectif au nom le plus proche, de majorité, qui suit le genre du groupe le plus nombreux, ou de choix en fonction de la valeur qu’on attribue aux noms. Comprendre que « si on parle d’une dame et de son déambulateur qui ont été percutées, on accordera le participe au féminin, car on estime que la femme est plus importante que l’appareil », décortique l’historienne, autrice de Non, le masculin ne l’emporte pas sur le féminin et Le langage inclusif : pourquoi, comment (Éditions iXe). Elle poursuit : « La volonté, avec cette règle du masculin qui l’emporte sur le féminin, était de faire en sorte que la langue suive le reste. Les grammairiens qui l’ont instaurée vivaient déjà dans une société inégalitaire, où le droit, les coutumes, les pouvoirs étaient inégalitaires, et ils trouvaient la langue trop égalitaire. Donc, ils ont inventé des règles, ont voulu faire disparaître des mots qui donnaient une légitimité aux femmes, pour réserver leur exercice aux hommes. Celles qui étaient autrices, médecines, poétesses, philosophesses, avaient une légitimité – la langue la leur accordait – dont ils ne voulaient pas ».
Leur but n’a rien de secret, les écrits de l’époque en attestent : que les femmes restent à leur place, que leur savoir, leurs exploits, leur quotidien ne soient surtout pas mis en avant ni rapportés. En 1651, l’Académie française décrète que : « Parce que le genre masculin est le plus noble, il prévaut seul contre deux ou plusieurs féminins, quoiqu’ils soient plus proches de leur adjectif. En 1767, elle ajoute : À cause de la supériorité du mâle sur la femelle. » Difficile de nier la misogynie qui nourrit le propos. « Quand on parle au masculin, on pense au masculin. Donc, on oublie les femmes. Ça a été très bien démontré par les psycholinguistes, précise la professeuse. Il faut restituer, dans le domaine de la langue, l’égalité comme il faut la restituer ailleurs, par exemple en politique, avec la parité. Il ne faut laisser aucun domaine de côté. Et la langue est une pratique sociale qu’il faut revisiter et analyser. C’est une question de justice, et de justesse.»
Ces précisions essentielles permettent ainsi de « comprendre l’histoire, de situer les choses dans le temps, de [faire] jaillir des questions », estime Éliane Viennot. Mais aussi, de redonner leur importance aux femmes et aux minorités de genre, et de « voir le sexisme des sociétés – les anciennes et la nôtre ». Pour mieux préparer l’avenir ? Certainement. Preuve que la révolution est en marche : ces dernières années, ces revendications ont infiltré les bancs de l’école.
« Au lycée, un excellent objet de débat »
Dans ses classes de première et de BTS, Françoise Cahen n’a parfois même pas besoin d’introduire ces pratiques linguistiques égalitaires. Ses élèves le font seul·es. « Beaucoup sont très remonté·es, constate l’enseignante. Certaines jeunes filles me disent être révoltées contre la règle du masculin qui l’emporte sur le féminin depuis toute petite ». De ces remarques légitimes naissent alors de longs échanges, au cours desquels les positions se prennent, l’esprit critique et d’analyse s’affine. « Au lycée, c’est un excellent objet de débat, note-t-elle. Par ailleurs, apprendre le français comme objet d’étude vivant plutôt que comme une espèce de norme à imposer sans discussion, peut aussi réconcilier des élèves avec la langue et notre rapport éducatif à la langue ». Ça ne fait aucun doute.
On aborde ensuite avec l’enseignante-chercheuse un autre aspect de l’écriture inclusive qui hérisse le poil de l’Éducation nationale : le pronom non genré « iel ». Elle le connaît bien et là encore, y voit un « engagement intéressant », une démarche bienveillante de la part d’une génération qui a soif de questionner des acquis problématiques. « J’ai des élèves qui ont une réflexion sur le genre, qui emploient même [ce pronom] à l’oral. Tout d’un coup c’est une nouveauté, ça surgit dans le quotidien de façon naturelle, car c’est tout un groupe qui s’y met, et ça fonctionne. Que des jeunes investissent comme ça la plasticité de la langue, c’est quelque chose de tout à fait heureux ».
Heureux, mais pas académique. Si elle accepte sans problème que cet activisme linguistique s’immisce jusque dans les copies de ses lycéen·nes et étudiant·es – par des pronoms, des accords ou des points qui ouvrent des possibilités – Françoise Cahen est obligée de les prévenir que le jour de l’examen, la personne en charge de la correction pourrait les sanctionner. Paradoxal, quand on sait que, à part les alternatives qui s’affranchissent de la binarité (« iel », le « x » qui s’accole à la féminisation d’un mot pour désigner les personnes qui préfèrent être identifiées par un neutre grammatical), tout ce que propose l’écriture inclusive existe déjà dans les manuels… depuis de nombreuses années.
«Il n’y a rien à inventer»
« C’est très sain que les gens recommencent à penser à leur langue »,reconnaît à son tour Éliane Viennot. L’historienne souligne d’ailleurs que, contrairement à d’autres lignes de la société à faire bouger (le milieu professionnel ou la politique qu’elle citait plus haut notamment), « il n’y a rien à inventer » pour rendre notre langue plus juste lorsqu’il s’agit de sa féminisation. « Nous savons faire, nous n’avons pas besoin d’inventer le mot “Française”, sourit-elle. Il existe plein de solutions pour éviter les doublets à l’écrit. » Les mots épicènes, les mots englobants (le « monde agricole » plutôt que les « agriculteur·rices », par exemple, ndlr), les points médians, les accords traditionnels de choix ou de proximité. « Nous avons les ressources, elles sont là. Simplement, il faut se former un petit peu, et savoir que ces ressources existent ».
À propos du point médian, elle rappelle que les « abréviations inclusives » existent sous la forme des parenthèses depuis environ un demi-siècle. On l’interroge : comment expliquer un tel rejet dans les derniers mois, une telle cristallisation du débat autour de ce caractère spécial à plus d’un titre, si le concept d’abréviation n’est pas nouveau ? « Je pense que c’est un problème d’idéologie, répond Éliane Viennot. Ce sont des gens qui réagissent par idéologie et qui n’ont pas réfléchi. » « Il y a le fameux fantasme qu’on va transformer Molière ou La Fontaine avec des points médians », s’agace de son côté Françoise Cahen, qui note que l’écriture inclusive doit avant tout être « un enrichissement et non un appauvrissement ». Et ne manque pas de mentionner que Molière lui-même utilisait l’accord de proximité dans ses pièces. Ironique.
On ne peut pas former les enfants à l’égalité en tenant des propos égalitaristes et en continuant d’enseigner que le masculin l’emporte sur le féminin. Il faut supprimer l’enseignement de cette règle inutile et dévastatrice, et recommencer à apprendre la règle de proximité qui a été enseignée jusqu’au début du XXe siècle, et l’accord selon la logique ou l’importance, qu’on ne découvre plus qu’à l’université.
Pour le linguiste Christophe Benzitoun, enseignant-chercheur à l’université de Lorraine, cette réaction qu’on pourrait qualifier de quasi épidermique n’est ni plus ni moins qu’une stratégie délibérée. « L’écriture non sexiste est devenue un épouvantail politique, analysait-il dans une interview pour France Culture parue en mai 2021. Dès qu’il y a une difficulté, le ou la responsable politique brandit ce sujet comme pour faire diversion. Parce qu’en réalité, le ministre de l’Éducation sait très bien que l’écriture inclusivene se réduit pas au point médian et que la véritable difficulté pour les élèves, c’est notre orthographe ». Aux réfractaires qui s’inquièteraient du sort des enfants en difficulté, justement, rappelons que les dictées continuent d’être notées au primaire et au secondaire, tout comme l’orthographe aux examens dont le français n’est pas le sujet. Un procédé particulièrement pénalisant pour ces mêmes élèves, qui ne semble, cette fois-ci, pas provoquer de controverse nationale.
Reste à savoir : les personnes dyslexiques, dyspraxiques ou déficientes visuelles qui nécessitent un lecteur d’écran s’en retrouvent-elles défavorisées ? Aujourd’hui encore, les avis des concerné·es comme des expert·es qui les accompagnent divergent. Le Réseau d’Études HandiFéministes (REHF) a toutefois dénoncé, dans un billet paru en décembre 2020, « la récupération du handicap pour justifier des positions anti-écriture inclusive. De fait, lire un point médian avec un lecteur d’écran est, à l’heure actuelle, quelque chose de désagréable, voire d’incompréhensible. Mais si les programmateur·rices travaillaient à modifier cela, il n’y aurait plus de problème », estime le collectif de chercheur·euses, pour qui il est plus urgent de « condamner le sexisme qui préside à la programmation des logiciels, plutôt que l’anti-sexisme qui motive l’usage de l’écriture inclusive.»
Et puis, c’est une question de bon sens: « On ne peut pas former les enfants à l’égalité en tenant des propos égalitaristes et en continuant d’enseigner que le masculin l’emporte sur le féminin, martèle la professeuse Éliane Viennot. Il faut supprimer l’enseignement de cette règle inutile et dévastatrice, et recommencer à apprendre la règle de proximité qui a été enseignée jusqu’au début du xxe siècle, et l’accord selon la logique ou l’importance, qu’on ne découvre plus qu’à l’université. »
À l’heure de l’hyperdigitalisation et de l’écrit comme moyen principal de mener ses luttes et de partager son vécu, ça nous paraît, à nous, une évidence. À tel point qu’on a voulu l’inscrire de manière indélébile, dans notre nom. Car « faire du français une grande cause », comme le scandait Valérie Pécresse en janvier dernier au micro d’Europe 1, promettant que, une fois élue, elle interdirait l’écriture inclusive, ne doit pas signifier plaider pour qu’il reste figé. C’est au contraire œuvrer à ce qu’il représente et véhicule l’évolution qu’on tente d’insuffler à la société. C’est célébrer le changement qu’il peut incarner, les idées qu’il peut soulever, la modernité qu’il est légitime de diffuser, par le biais de quelques réflexes simples à prendre. C’est faire en sorte qu’il parle à toustes, et qu’il permette à chacun·e de s’exprimer précisément et librement. Parce que, n’est-ce pas là toute la fonction, toute la beauté de la langue, finalement ?