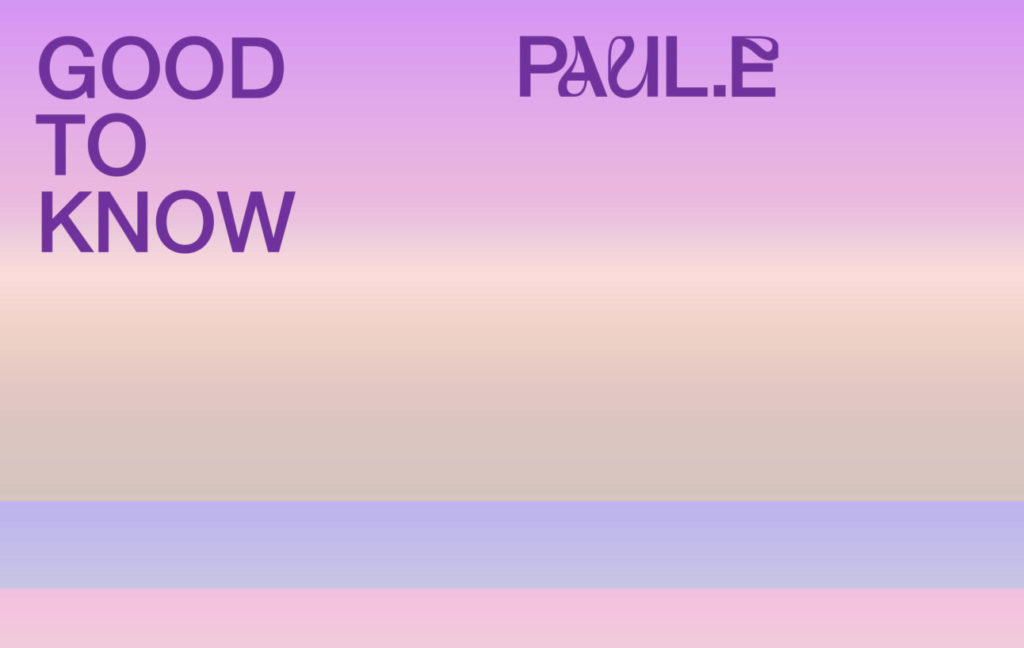Sarah Makharine, « La photographie, c’est aller à la rencontre des gens »
Entre théâtre, cinéma, production et photographie, Sarah Makharine a façonné son talent et forgé ses engagements, pour aujourd’hui exprimer une fibre artistique exceptionnelle et pleine de sens.

Diplômée de l’école Kourtrajmé, cette touche-à-tout prend désormais son appareil afin de mettre en lumière les corps dits invisibilisés. Sa passion et sa curiosité l’ont guidée vers la Turquie ou encore le Kosovo, à la rencontre des femmes et de leurs corps. Entretien avec une artiste qui fige le mouvement et le moment comme personne, guidée par l’ambition de véhiculer des messages forts.
PAUL·E : Quel est ton plus vieux souvenir photographique devant ou derrière la caméra ?
S.M. : De manière hyper simple, le Macadam. C’est rue du Faubourg Poissonnière. J’ai commencé la photo avec les Kodak jetables. Je me souviens avoir acheté un Kodak avec lequel je me baladais et d’être tombée sur un marquage au sol qui disait « place payante » avec des bris de verre tout autour. J’ai mis le flash, j’ai mis mon pied dessus et j’ai pris la photo !
P. : Comment est née ta passion pour la photographie ? Quel est ton parcours ?
S.M. : J’ai fait du mannequinat quand j’étais très jeune. Du mannequin du dimanche, mais je trouve ça cool de l’assumer. Puis, arrive ce moment où je commence à faire des études théâtrales. Venant du 92, je traversais tout Paris pour me retrouver dans le 5ème arrondissement, comme dans un film de Rohmer. Je crois que c’est à ce moment-là que l’esthétisme est rentré dans ma vie par l’image. J’ai suivi des cours portés sur l’analyse filmique à l’université. Et j’ai commencé à me rendre compte que le mannequinat et l’acting étaient une toile de fond pour m’amener à une sémantique beaucoup plus profonde, qui était celle de la rencontre avec le texte et l’image. Donc, je postule à Saint Denis en audiovisuel. Et là, révélation. Je commence à questionner ce que je veux faire plus tard et je commence à croire que ma place est derrière plutôt que devant la caméra. Je suis très fière d’avoir fait cette école à Saint-Denis, moi qui photographie aujourd’hui les invisibles, c’est-à-dire les invisibilisé·es qui sont les gens qui me bouleversent et me touchent. Je les photographie dans des scènes du quotidien, mais j’ai toujours envie de les voir extraordinaires. À chaque fois que je déclenche mon appareil, j’ai vraiment besoin de cette rencontre.
P. : Quelles sont justement les rencontres décisives qui ont jalonné tes débuts ?
S.M. : De fil en aiguille, j’avance, je fais des stages et je me retrouve chez Iconoclaste. Puis, je fais la rencontre d’une femme et journaliste incroyable qui s’appelle Saphia Azzedine. C’est elle qui, à mes 24 ans, m’a permis de jouer dans son film, mais aussi de réaliser les photos d’une campagne pour sa marque (alors que je n’étais pas photographe) à Belleville. Malheureusement, sa marque n’est jamais sortie au même titre que ce shoot, mais j’en garde un très bon souvenir. C’était un moment de sororité intense avec une femme qui m’a fait confiance de A à Z. Grâce à elle, j’ai pris confiance en moi, j’ai fait de la direction artistique sur des clips, j’ai travaillé dans une autre boîte de production pendant un an et demi. Puis, le confinement est arrivé en mars 2020. Comme beaucoup de personnes, je me suis remise en question et j’ai eu envie de créer des choses cool inspirées de la rue. Avec une amie, on décide de faire des créa pour Guerrisol, qui était à l’époque une friperie bas de gamme, avec l’espoir de peut-être réussir à changer les choses qu’on détestait dans le milieu de la publicité. On fait ces photos entre copines, à Barbès, et on produit quelque chose qui a du sens pour nous. Après cette campagne, j’intègre l’école Kourtrajmé et commence cette folle aventure qui m’a permis, je pense, d’être là où je suis aujourd’hui. J’ai également eu la chance de partir en Turquie pendant deux mois sur un long métrage qui s’appellait « After Sun » où là, aussi, ça a changé ma vie. Quand je suis sortie de l’école, tout s’est un peu enchaîné. Dans ce processus, je me rends compte que beaucoup de femmes m’ont aidée et ont changé ma vie.
P. : Quel a été le but de ta démarche en questionnant les femmes sur leur féminité à travers la religion ?
S.M. : C’était le projet de fin d’études de Kourtrajmé. Ne pouvant pas encore parler de ma mère et de ce rapport avec elle, j’ai décidé de travailler sur le corps des femmes, et ce que je voulais c’était faire rallier ce côté âme et ce côté corps, qui m’ont toujours questionné. Qu’est-ce qu’une identité religieuse ? La religion fait peur et je me suis toujours questionnée sur ce qui faisait peur. Pour moi, l’hypersexualisation du corps des femmes actuellement, est née des religions. Mais ça, personne ne veut en parler. Parce que c’est quelque chose qui est trop sensible et je le comprends. La religion est un sujet qu’il est nécessaire d’aborder parce qu’on pourra manifester, on pourra faire plein de choses, mais si on ne s’attaque pas vraiment à la source du problème, qui sont les textes, qui est : « Pourquoi aujourd’hui on cache le corps des femmes ? Pourquoi aujourd’hui dans le judaïsme, dans la religion musulmane ou même dans la religion catholique, on demande à la femme de se cacher ? ». Alors rien ne changera. Ce sont des questionnements. Alors, je suis partie interroger ces femmes parce que c’était aussi de mon devoir de les rencontrer, et de ressentir pourquoi est-ce qu’elles faisaient ça. Donc, je suis allée les rencontrer, que ce soit dans le 95, que ce soit en Palestine, ou que ce soit chez les nonnes. J’ai questionné ce corps et cette hypersexualisation. Et je pense que tout mon travail aujourd’hui consiste à créer de nouveaux imaginaires collectifs. Et donc, “Le Mikve” était ma première œuvre et c’est ce qui a donné place à mon gros projet qui s’appelle “Âme sœurs”. Donc, j’ai un projet sur la place des femmes dans les communautés, qui vise à rencontrer ces dernières un peu partout dans le monde, afin de créer des moments de sororité, de s’écouter les unes les autres et d’essayer d’avancer ensemble parce que je reste persuadée qu’un enfant éduqué sera toujours un enfant qui se questionnera.
P. : Tu parles aussi de la place du sport dans l’émancipation de la femme. Quels préjugés as-tu voulu combattre ?
S.M. : Ce sujet, c’est Ramallah to the Eiffel Tower. C’est un sujet où j’ai voulu comprendre comment les femmes pouvaient s’émanciper à travers le sport, sur les territoires en situation de conflit. En fait, le sport est une possibilité pour la femme d’aller à l’encontre de l’homme. Et ça, c’est quelque chose d’assez intéressant. Le sport leur permet de créer une confiance en elles, qui parfois peut être altérée par leur quotidien et par leur communauté. Ce qui m’intéressait, c’était vraiment d’essayer de comprendre comment elles arrivaient à appréhender l’activité sportive. Et de là, j’ai pu voir énormément de choses, comme le plaisir qu’elles avaient à pouvoir faire bouger ce corps malgré leur pudeur. Je voulais les rencontrer dans les lieux où elles pratiquaient une activité physique, mais surtout dans leur pays. Donc là, j’étais justement à Ramallah où les femmes sont séparées des hommes au sein des universités. Et ce que j’ai vraiment remarqué, c’est cette sororité à toute épreuve, c’est à dire qu’il y a un lâcher prise total et que le sport leur permet une réelle émancipation, et je crois même une rencontre avec leur propre corps. Certaines ne le conscientisent pas, mais nous, en tant qu’occidentales, le fait de le regarder et de le percevoir, c’est quelque chose de très beau. C’est pour moi un nouvel imaginaire collectif de voir une femme qui normalement n’a pas le droit de pratiquer un sport, le faire malgré tout. C’est quelque chose de fort.
P. : Tu questionnes l’intersection des genres. Quel a été le point de départ de ce projet ?
S.M. : Le point de départ de ce projet, ça a été : “Bonjour, vous allez exposer à la galerie. Votre sujet est “l’intersection”. Vous avez deux semaines.” (Rires) Plus sérieusement, le corps a toujours pris une place centrale dans ma vie artistique. Et je voulais parler de la communauté LGBT qui, à l’époque, était vraiment en train de s’exprimer. Mais, je ne me sentais pas légitime. J’ai toujours fait très attention à la question de ma légitimité : « Qui je suis moi pour photographier ces gens-là ? Et attention au message qu’on va porter. » Dans mon travail, je veille toujours à allier esthétisme et profondeur. Et le sujet “intersection” a été l’occasion de me creuser les méninges, et de regarder autour de moi. Je décide donc de travestir mon père. J’ai travesti mon père parce que qu’il a été, dans ma construction identitaire, cet homme des années 70, macho, qui représente tout ce qu’aujourd’hui on déteste. Et, je l’aime profondément. Je crois que le fait de le travestir était pour moi un acte de possession totale de ma féminité, mais aussi un acte de changement des imaginaires collectifs. Je voulais questionner son genre, mais surtout questionner la construction de mon identité féminine à travers le prisme de celui qui avait construit en moi cette idée du prince et de la princesse. Au moment de la prise de photos, il ne conscientise pas ce qui est en train de se passer et il le fait uniquement par amour. Et ce qui m’intéressait là-dedans, c’est que cette question du genre doit être transcendée par le regard des autres et surtout par un amour puissant. Ce sont des questions identitaires profondes mais surtout des revendications qui ont beaucoup trop longtemps été invisibles. Et pour moi, ce qui importait était de montrer que grâce à l’amour, quoi qu’il arrive, on pourra faire plein de choses. Et le fait que mon père se travestisse, qu’il se questionne sur le genre, sur les actes qu’il était en train de faire, qu’il se maquille, c’était tout simplement magnifique.
P. : Comment se passe la collaboration avec tes modèles ?
S.M. : Je ne peux pas photographier quelqu’un que je n’aime pas. C’est terrible d’ailleurs. Mes photos que je considère comme nulles, ce sont des photos où j’ai senti qu’il ne se passait rien. Et donc non, je n’ai pas de réels critères. Il s’agit plutôt d’une question de feeling, d’envie, de passion. Est-ce oui ou non j’ai envie de photographier la personne. Je veux faire parler les gens et les écouter, c’est ça qui m’intéresse. La photographie, c’est aller à la rencontre des gens, et passer un moment ensemble.
P. : Ta curiosité t’a beaucoup fait voyager. Pourquoi le Kosovo ?
S.M. : En fait, le Kosovo, c’est très simple. Pour moi, c’est la première guerre que j’ai rencontrée quand j’étais petite. Je me suis dit qu’il fallait que j’y aille. Il y a énormément de choses qui s’y passe. C’est comme un pays émergent. Et effectivement, j’ai eu cette chance de photographier une femme qui était en train de faire ses photos de mariage. Je me rappelle être en voiture, et là, je vois cette femme et je descends de la voiture. Je la vois, et je ne peux pas te dire ce qu’il se passe. Je sens tout : je sens qu’elle a 22 ans, que son mari pour elle, c’est une forme d’émancipation, qu’elle n’est pas très à l’aise dans tout cet apparat et dans ce patriarcat tellement puissant qui se passe justement dans ces pays, après conflit. Et c’est ce que je voulais également interroger. La place des femmes dans ces communautés.
P. : Quel regard portes-tu sur le marché de la photo entre passion et business ?
S.M. : C’est une très bonne question. (Rires) Je suis complètement entre les deux, c’est-à-dire que je viens du milieu de la publicité. J’ai travaillé avec de très grands photographes que j’admire énormément. Ce sont des photographes de mode, qui ont un sens de l’esthétisme qui est très puissant et fin. Et justement quand je suis rentrée à Kourtrajmé, j’ai dû déconstruire toute cette idée de la beauté, et tout simplement m’en détacher. Et donc, « Endless Summer », c’est la série née d’une commande photographique de Jean-Pierre Blanc, un homme qui fait beaucoup pour les institutions justement, institutions pour lesquelles j’ai jamais vraiment essayé de travailler. J’ai rencontré Jean-Pierre Blanc, qui est le directeur de la Villa Noailles, lors d’une conférence au 19M. Mais, je ne le savais pas à l’époque. Je vois juste un gars avec une grosse barbe blanche, hyper cool et qui nous a dit pendant la conférence : « Vous savez, le monde de l’art, on n’est pas obligé d’être des gros connards. On peut aussi s’aimer et être des bisounours ». Et là, j’ai tout de suite adoré cet individu. De fil en aiguille, on se parle, je lui fais une photo avec mon Kodak, il me recontacte quelques jours après pour me proposer de travailler ensemble. Donc, ça s’est fait comme ça, naturellement, parce que c’est l’humain. La Villa Noailles, c’est cool, mais moi ce que j’aime, c’est ce que tu crées avec les gens. Et que ce soit Jean-Pierre Blanc, que ce soit les équipes aussi, Jeanne, Saeed, Julie, ce sont des gens incroyables qui te donnent une possibilité de t’exprimer. C’est l’humain, c’est vraiment l’humain. In fine, c’est une question de choix : « Qu’est ce que tu veux ? Est ce que tu veux aller faire la prochaine pub Nocta ? » Grave, je serais trop chaude si on me donne une carte blanche pour faire Nocta; mais avec des meufs ou des keums du quartier, des vrai·es. Mais si tu veux faire ça, pour moi, il faut la légitimité. Donc, il faut que tu connaisses les gens. Vu que la base de mon travail c’est l’humain, cette sémantique est nécessaire pour moi. Je pense qu’il y a une chose qui ne mentira jamais, c’est le cœur. Si ton cœur dit oui, même si c’est une pub pour Darty. Et, même si on est beaucoup sur le marché, moi je veux qu’on se soutienne tous·tes ensemble. Moi j’y crois. Je crois vraiment au collectif. Je suis peut-être folle, mais je crois vraiment à ça.

P. : En tant que femme photographe, te sens-tu seule dans ce milieu ? Comment encourages-tu d’autres femmes à se lancer ?
S.M. : Différencier ton travail par ta sexualité, je ne veux plus que ça existe. Demain, si j’ai une fille, je veux qu’elle puisse faire n’importe quel travail. Qu’elle n’ait pas cette sensation de ne pas être légitime. Donc non, moi en tant que femme photographe, je me sens à ma place. Mais, ce qui est parfois difficile à gérer c’est cette absence de sécurité quand, justement, tu es une femme, parce que ton corps est hypersexualisé. Cependant, peu importe ta sexualité et ton genre, on s’en fout. Ce qui fera ta force et ta légitimité, c’est ta passion. Et si ta passion, c’est l’humain, il faut y aller. Et ça, c’est vraiment le conseil que je donne à tout le monde, car personne ne te donnera ta légitimité. C’est ta passion qui te la donnera.
P. : Sens-tu que tu évolues à travers ton travail ? Quels sont tes projets à venir ?
S.M. : Je me sens évoluer dans ce que je ne veux pas faire. C’est déjà bien. J’avance vers ce que j’aime le plus. Je pense que dans n’importe quel travail, il arrive un moment où tu dois tout faire, tout essayer, tout décadrer pour recadrer par la suite. Effectivement, le cinéma est la chose vers laquelle je me dirige, notamment le cinéma documentaire, et l’image en mouvement. Je pense que maîtriser l’image statique me permettra de maîtriser davantage l’image en mouvement. Et comme ma passion c’est l’humain, j’aimerais peut-être réaliser un film. Mais, je veux aussi continuer cette carrière photographique comme une carrière d’archives. Tout simplement montrer, créer des choses, des expos, en collectif, et juste s’aimer. Et je crois que le “nous” est nécessaire. C’est l’humain qui crée les inégalités, c’est l’humain qui crée la misère du monde. Donc, à nous de nous rassembler, à nous de nous aimer et de nous soutenir les uns les autres. Voilà, c’est le mot de la fin.
P. : Merci Sarah Makharine !
Propos recueillis par PK Douglas.