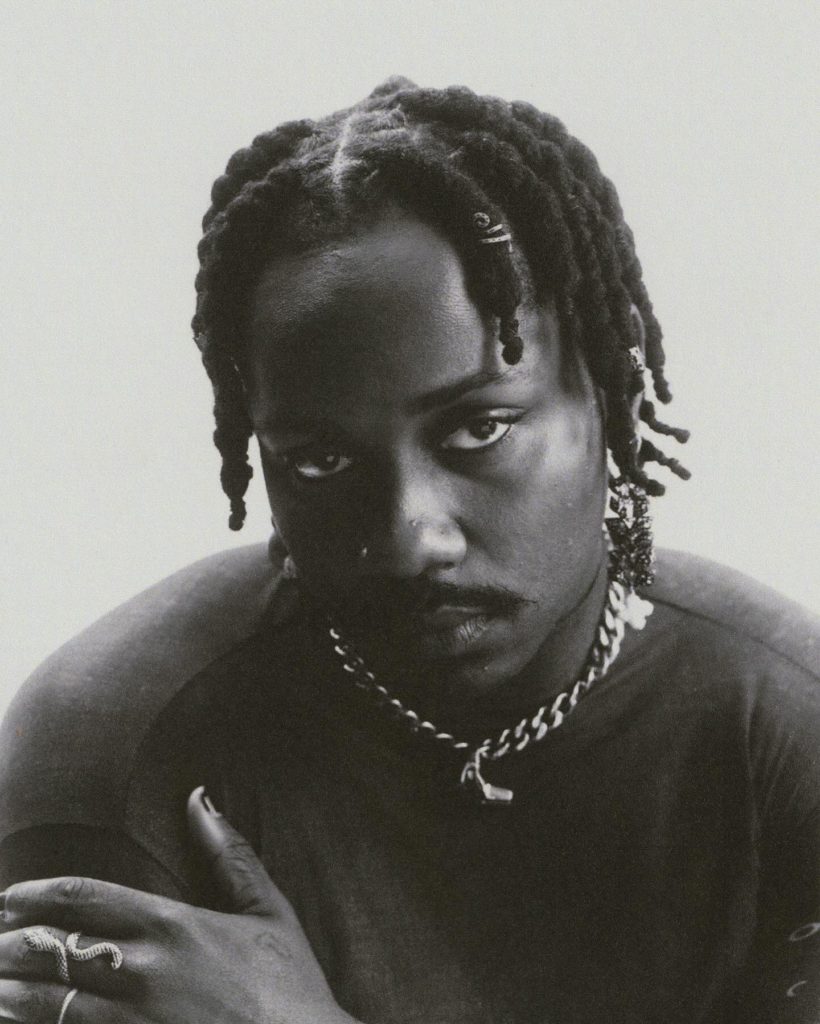FATOUMATA KEBE : VISER LA LUNE

À 32 ans, la chercheuse française est une touche-à-tout. Après avoir soutenu une thèse sur les débris spatiaux en 2016, elle développe aujourd’hui un système d’irrigation connecté pour réduire les dépenses en eau, tout en menant de front des ateliers de vulgarisation scientifique auprès des jeunes de 2 à 16 ans. Un emploi du temps bien chargé, qui rend cette étoile filante difficile à saisir. Entre deux voyages à l’étranger, nous l’avons rencontrée en terrasse d’un café parisien pour parler de son parcours passionnant, de ses travaux et de ses projets d’avenir.
Propos recueillis par Lison Herledan
Tu as soutenu ta thèse il y a deux ans. Où en es-tu aujourd’hui ?
Je partage mon temps entre trois projets. Le premier concerne mon entreprise au Mali, Connected Eco, qui s’occupe de faire des objets connectés dans le secteur agricole. Je suis accompagnée pendant un an par la French Tech Diversité à Bondy, tout en ayant un financement pour réaliser les prototypes de mon système d’irrigation. Il y a ensuite l’association Éphémérides, créée il y a quatre ans et demi, au sein de laquelle je prépare des ateliers d’astronomie pour les scolaires en Île-de-France, et depuis peu au Mali : dans un lycée privé pour jeunes filles ainsi que dans un quartier de Bamako. Et bien sûr, il y a toujours la recherche ! Je continue à bosser sur les débris spatiaux avec un chercheur aux États-Unis et je fais aussi partie d’une équipe américaine qui travaille sur un type de nuage dans l’atmosphère qui pourrait nous renseigner sur le changement climatique.
Rien que ça… Tu aimes être sur plusieurs fronts ?
J’essaie de me cadrer (Rires) ! Quand on termine une thèse, on fait généralement un post-doc, c’est-à-dire des CDD pendant au moins cinq ans pour devenir fonctionnaire et être officiellement astronome. Il y a très peu de places. En France, je me présente comme docteure en astronomie, mais ça me va. Il y a tellement de choses à faire, je n’ai pas de temps à perdre. J’ai envie d’avoir un impact direct ! Quand je vois les jeunes qui repartent avec leurs maquettes du système solaire, ils ont appris quelque chose. C’est concret. Pareil pour Connected Eco, ce n’est pas qu’une avancée technologique, c’est surtout un progrès social.
Peux-tu nous expliquer en quoi consiste ce projet ?
C’est un système d’irrigation composé d’une pompe solaire qui crée un accès direct entre un point d’eau et un champ. On appose des capteurs à même le sol qui vont prendre des mesures en fonction de l’humidité et d’autres paramètres afin de quantifier les besoins exacts en eau. Une fois l’information connue, un système d’arrosage se met en marche. 70 % des ressour-ces en eau potable mondiales sont utilisées dans l’agriculture et la moitié est gaspillée à cause des mauvaises pratiques d’irrigation. Le projet permet une réduction des dépenses en eau. Ça réduit également la pénibilité au travail, puisque les allers-retours sont évités. Le système couvre de grandes surfaces en diminuant l’effort, il y a donc moins besoin de main-d’oeuvre. Les enfants qui aidaient aux champs ne sont plus indispensables et ce temps libéré permet une scolarisation !
Quels sont les résultats obtenus ?
Pour l’instant, on teste les prototypes sur trois mois. Ils fonctionnent, mais nous ne sommes pas pleinement satisfaits des résultats. Nos chiffres en termes d’irrigation ne sont pas assez bons, on pourrait mieux faire avec de meilleurs matériaux. On y travaille ! Je réfléchis à de nouveaux composants, tout en réduisant les coûts de fabrication pour rester rentable. Il y a également des paramètres que je n’avais pas pris en compte au départ : plusieurs plans d’eau au Mali sont pollués, par exemple.
La plupart des gens t’ont connue grâce à ton travail de thèse. Comment le présenterais-tu à ceux qui n’ont aucune notion d’astronomie ?
J’ai travaillé sur les débris spatiaux, c’est-à-dire les déchets de l’espace : les vieux satellites, les morceaux de fusées, les écailles de peinture, les vis… Le but de ma thèse était de modéliser ce qui se passe quand deux satellites entrent en collision. Le nombre de débris qui vont être générés, comment ils vont se comporter autour de la Terre, pendant combien de temps ils vont polluer l’environnement spatial. Il fallait prendre en compte plusieurs éléments pour calculer cela. J’essaie toujours de trouver une loi mathématique ! Je me suis également un peu intéressée à la question du nettoyage de ces débris. J’avais commencé à élaborer un projet d’entreprise de nettoyage de l’espace, car ma fac proposait des formations en entrepreneuriat pour les chercheurs !
Quelles solutions existent pour nettoyer l’espace des débris ?
C’est compliqué, car des questions politiques et financières entrent en jeu. Les équipes de nettoyage se focalisent généralement sur les gros débris comme les satellites. C’est plus facile, car on sait à qui ils appartiennent, donc on identifie qui va payer en cas de collision. Selon les estimations de la NASA (National Aeronautics and Space Administration, ndlr), il y a entre 17 et 20 000 gros débris. C’est énorme ! Mais ceux de 1 à 10 centimètres sont près de 700 000 ! S’ils impactent un satellite à un endroit stratégique, ils peuvent le détruire. Le problème, c’est qu’il est difficile de dire à qui ils appartiennent. Pour qu’une mission nettoyage soit rentable, il faut enlever au moins 5 gros débris par an. Sur 5 déchets, il y en a peut-être un qui est américain, l’autre russe… et en tant qu’Européen, on n’a pas le droit d’y toucher. On ne peut retirer que ceux de sa nationalité. Il faudrait donc négocier un accord avec chaque pays. En cas d’échec, on aurait investi pour rien !
Rien ne pourra changer à ce niveau ?
Des technologies ont été pensées, comme les harpons, les filets ou même les ballons. Accrochés à un satellite, ces derniers sont capables de modifier sa trajectoire pour le faire rentrer sur Terre. Le problème, c’est que leur efficacité n’est basée que sur des estimations. L’agence spatiale japonaise avait fait un essai il y a deux ans, soldé par un échec. Toutes ces techniques coûtent très cher et il n’y a pas assez de soutien financier de la part des États. Ce n’est pas une priorité. Pourtant, la NASA a indiqué que d’ici 2025, un satellite envoyé dans l’espace rencontrera forcément un débris sur son trajet. Envoyer des satellites est coûteux. Il va potentiellement y avoir de plus en plus de pertes d’argent s’ils sont détruits. C’est triste, mais je pense qu’on ne réagira que quand un événement grave se produira dans l’espace.
Tu as longtemps hésité entre l’environnement et l’espace pour tes études, ta thèse était un parfait mélange des deux ! Qu’est-ce qui t’a donné envie de te lancer dans ce domaine ?
Quand j’étais petite, on m’a offert une encyclopédie et j’étais fascinée par les images de constellations. Tous les dimanches, beaucoup de documentaires sur l’astronomie étaient diffusés sur la 5. J’adorais ! Un jour, j’ai rencontré l’ingénieur Christophe Bonnal à une conférence, il travaillait sur les débris et l’espace, c’est lui qui m’a donné beaucoup d’informations sur le sujet et qui m’a mise en contact avec les professionnels du secteur. Il faisait partie de mon jury, je le respecte beaucoup. La scientifique Claudie Haigneré m’a aussi vraiment inspirée. On ne la voit pas assez dans le paysage médiatique français. À la base, elle était médecin avant de partir en mission dans l’espace. Dans les années 90, je la voyais partout à la télé. Quelques années plus tard, je me suis retrouvée dans son bureau, ça m’a fait trop bizarre ! J’essayais de parler normalement, mais d’un autre côté, j’avais envie de dire : « Viens, on fait un selfie » (Rires) !
Toi aussi tu as voulu partir dans l’espace, non ?
Oui ! Je venais à peine de finir mon master en 2009 et l’agence spatiale européenne cherchait sa prochaine promotion d’astronautes, dans laquelle on retrouve d’ailleurs Thomas Pesquet. Mon profil n’était pas assez fort. J’étais une jeune diplômée, peu expérimentée, et puis il faut voir le dossier (Rires) ! Déjà que j’ai du mal avec les démarches administratives, alors là ! Ils posent énormément de questions…
Pour devenir astronaute, quel profil faut-il avoir ?
Il faut être scientifique. Médecin, chercheur, ingénieur, ou pilote. Il y a des qualités spécifiques à avoir : être à l’aise dans le travail d’équipe et respecter la hiérarchie, par exemple. Si le commandant de bord te donne un ordre, il faut l’exécuter. Clairement, tu mets ton orgueil et ton ego de côté. Et une bonne gestion du stress est primordiale ! Dans un documentaire, j’avais vu un astronaute italien rencontrer un problème lors d’une sortie extra-véhiculaire. De l’eau commençait à monter dans son casque. N’importe qui se dirait : « Je suis dans l’espace et je vais potentiellement me noyer », mais lui a géré ! La formation t’aide, mais il faut avoir de bonnes bases. Si je déposais mon dossier, je devrais reprendre le sport et apprendre une autre langue, comme le chinois ou le russe. Dans tous les cas, envoyer des gens dans l’espace n’est pas la priorité de l’Europe dans les prochaines années. Je regarderais plutôt du côté des États-Unis.
Tu as tes chances, si on regarde ton parcours ! Peux-tu nous le présenter ?
Je suis un pur produit de l’Université Pierre-et-Marie-Curie ! J’y ai fait ma licence d’ingénierie mécanique, mon master en mécanique des fluides et mon doctorat d’astronomie. Ma formation de base était trop généraliste. Pour rendre mon parcours plus axé sur l’espace, j’ai fait une année universitaire au Japon. Là-bas, je concevais des mini satellites tout en suivant des cours pour me mettre à niveau. Ensuite, j’ai fait des stages à la NASA, à l’International Space University et dans des laboratoires du CNRS (Centre National de Recherche Scientifique, ndlr). J’ai beaucoup appris.
Quelle place ont les femmes dans ces milieux scientifiques ?
Il y en a ! Mais plus les études avancent, plus elles disparaissent. Très jeunes, on nous détourne des sciences. En filière scientifique, au lycée, il y a 50 % de jeunes filles, mais elles y sont surtout parce qu’elle est un tremplin vers les filières dites sélectives, pas pour les matières enseignées. À l’université, on retrouve beaucoup de femmes en chimie et en biologie, et quasiment aucune en maths et en physique. Après une thèse, on est supposé faire un post-doc et là, c’est l’hécatombe ! À presque 30 ans, on se pose la question d’avoir une famille. Bouger tous les ans à l’étranger rend cela compliqué. Personnellement, j’ai connu un fort engouement médiatique après l’exposition « Space girls, space women », en 2015. Je suis une femme noire, née dans le 93, c’est du pain bénit pour les journalistes ! Mais je ne veux pas être la seule qu’on présente, car il y en a beaucoup d’autres qui font un travail tout aussi important !
Ton engagement auprès des jeunes est fort. Quel(s) message(s) souhaites-tu leur faire passer ?
On n’est pas assez accompagné pour définir nos projets professionnels ou scolaires. On ne sait pas vraiment ce qui existe après le bac. Je ne cherche pas à les faire devenir astronomes, l’idée que je veux véhiculer est : « Deviens qui tu veux en ayant vu ce qui existait ». Beaucoup d’adolescents savent ce qu’ils veulent, mais ils s’autocensurent. Quand ils me voient faire ce que j’ai tou-jours eu envie de faire, ils se disent que c’est possible. J’ai parfois été découragée par des profs, mais j’ai réussi. Ça n’a pas de sens de dire : « Quand on veut, on peut » ! C’est culpabilisant. Parfois, on perd confiance, ce n’est pas facile de tenir le cap. Dans ces moments, mieux vaut se tourner vers des gens qui nous soutiennent : les amis, la famille ou des assos pour entendre un autre son de cloche.
Quels sont tes objectifs pour l’avenir ?
Avec Éphémérides, on va certainement faire une petite pause pour se structurer. Tout ce qu’on a comme matériel, on l’a financé avec un prix de la Fondation de France que j’avais reçu. Mais aujourd’hui, on a besoin de plus de fonds pour renouveler nos stocks. Pour le moment, on loue, par exemple, un planétarium gonflable pour apprendre aux enfants à lire une carte du ciel. Aujourd’hui, on est accompagné par un programme pour avoir davantage de financements et obtenir un local fixe en Île-de-France. Au Mali, on aimerait équiper au moins 1 000 hectares d’ici la fin de l’année. Et puis la recherche, ça ne s’arrête jamais complètement !