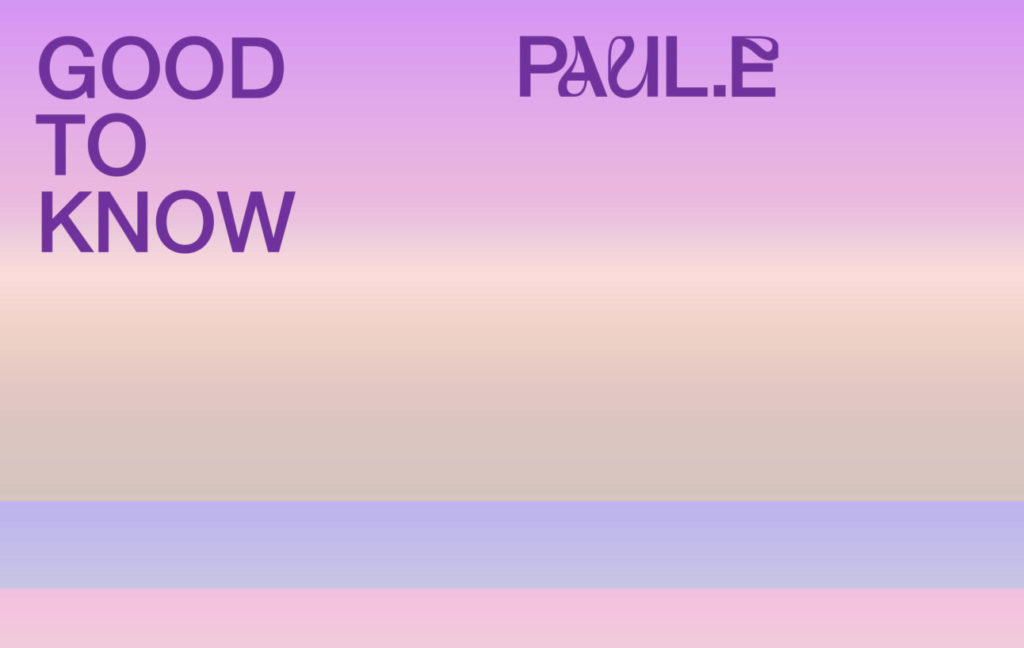Être une femme artiste, entre invisibilisation et reconnaissance
Si ces cinq femmes artistes sont reconnues dans le monde de l’art à des degrés divers, elles restent peu connues voire totalement méconnues du grand public.

Au carrefour des arts, des époques et des courants, ces cinq femmes artistes ont progressivement fait leur place dans le monde de l’art. Certaines ont produit une quantité d’oeuvres immense avant d’être inclue dans le circuit très fermé du marché de l’art. En (re)mettant la lumière sur leurs parcours et leurs oeuvres, c’est tout un pan de l’histoire de l’art qui se dévoile, loin des clichés sexistes encore projetés sur les femmes artistes. Si chacune d’elles mériterait un éclairage unique, penser simultanément leurs parcours ainsi que leurs oeuvres permet de dégager le caractère systémique de la méconnaissance du public à leur sujet.


Au carrefour de l’écriture et de la peinture
Etel Adnan est née en 1925 à Beyrouth au Liban. Sa vie est marquée par l’errance, les déplacements, du Moyen-Orient à l’Europe jusqu’aux États-Unis. Cette mouvance, cette migration existe aussi dans la forme que prend son travail au fil du temps. D’abord intéressée par la peinture, elle réalise exclusivement des toiles en petit format où cohabitent des aplats de couleurs vives, avant de s’orienter progressivement vers l’écriture. Polyglotte, elle est capable de composer de la poésie en arabe, en anglais, en turc mais aussi en grec, même si sa langue de prédilection reste le français. Elle dit d’ailleurs dans Écrire dans une langue étrangère qu’« elle n’avait plus besoin d’écrire en français [puisqu’elle] allait peindre en arabe ». Cette formule montre à quel point l’écriture et la peinture sont les deux faces d’une même médaille pour l’artiste. Elle est parvenue à les réunir, en utilisant des leporellos, un livre accordéon permettant de présenter sa peinture comme une histoire, en plusieurs temps, tout en y ajoutant des formules verbales. Preuve qu’Etel Adnan est à la fois peintre et écrivaine, elle a été décorée de l’ordre du Chevalier des Arts et des Lettres à l’occasion de sa rétrospective à l’Institut du monde arabe en 2016.


Ce mélange entre écriture et peinture est également présent chez l’artiste béninoise Pélagie Gbaguidi. Véritable griotte contemporaine, son travail est au carrefour des époques et des pays. Il possède une dimension politique et sociale forte qui tend à bouleverser l’ordre des choses. Avec Le Code noir, l’oeuvre qui l’a faite connaitre à la Biennale de Dakar en 2006, un ensemble de sept toiles qui évoque la violence du système esclavagiste, elle parvient à mêler l’écriture et plusieurs formes artistiques comme le dessin, la peinture ou encore la broderie. Concernant l’association de plusieurs formes artistiques, elle dit que ses oeuvres sont autant une forme d’écriture que de dessin.
En Belgique, pays au lourd passé colonial, elle anime des ateliers pour les jeunes axés sur la décolonisation des discours. C’est par l’art et la parole qu’elle souhaite orienter le public à comprendre l’histoire du pays. Son activité artistique s’apparente à un véritable travail de mémoire.

Le travail de mémoire et la question de la réhabilitation des femmes artistes
Julie Manet, fille de Berthe Morisot et d’Eugène Manet, a grandi dans un foyer bourgeois parisien à cheval entre le XIXe et le XXe siècles. D’abord muse de sa propre mère qui la représente dans 70 portraits, de son oncle, Édouard Manet, un des chefs de file de l’impressionnisme, elle suit une éducation artistique privilégiée. Elle développe sa sensibilité artistique auprès d’acteurs et d’actrices incontournables de son temps. Elle a pour tuteur le célèbre écrivain Stéphane Mallarmé. Entourée de ses deux cousines, Paule et Jeannie Gobillard, elle développe un style de peinture proche de celui d’Auguste Renoir.
Après la mort de ses deux parents, elle continue de peindre, mais se distance des salons et des galeries pour réhabiliter l’oeuvre de sa mère, Berthe Morisot. Avec son mari, Ernest Rouart, fils du peintre et collectionneur Henri Rouart, ils participent à la postérité de leurs parents. C’est grâce à eux que les oeuvres de Berthe Morisot rejoignent les collections des musées nationaux. En rachetant des oeuvres ayant appartenu à leurs parents, Julie et Henri effectuent un véritable travail de mémoire. Sans l’intervention et l’abnégation de Julie, le travail de Berthe Morisot ne serait pas entré dans l’histoire de la peinture française.


Elle-même, écrivaine et curatrice, Julie Manet est parvenue à réhabiliter le travail de sa propre mère, invisibilisée jusque dans son certificat de décès qui mentionnait qu’elle était « sans profession ». C’est notamment grâce à la publication de ses journaux intimes rendus publics pour la première fois en 1979, grâce à son fils qui honore à son tour sa volonté, que la lumière a pu être faite sur le travail qu’elle a effectué tout au long de sa vie. Preuve de la réhabilitation de sa mère, une rétrospective lui a été consacrée au musée d’Orsay en 2019 et une exposition lui est actuellement dédiée au musée Marmottan Monet.


Alors que Julie Manet faisait son possible pour que l’oeuvre de sa mère soit reconnue, naissait, de l’autre côté de l’Atlantique, à La Havane en 1915, Carmen Herrera, véritable pionnière de l’abstraction géométrique. Comme Berthe Morisot, il a fallu plusieurs décennies à l’artiste américano-cubaine (une soixantaine d’années) pour se faire connaitre dans le monde de l’art. Elle dit d’ailleurs qu’« elle a attendu près d’un siècle le passage du bus et qu’il s’est finalement arrêté ». L’embarquant vers le pays de la reconnaissance. C’est seulement dans les années 2000, à l’occasion d’une exposition sur l’abstraction à la Latin Collecter Gallery de Tribeca à New York et après le désistement d’une autre artiste latino-américaine, que Carmen Herrera parvient à attirer l’attention des critiques et des féru·es d’art. À partir de cette exposition, sa côte sur le marché a explosé. Elle est depuis exposée au MoMA à New York ou au Tate Modern à Londres, le Whitney Museum of American Art lui a également consacré une rétrospective en 2016.

Le queer gaze de Leonor Fini
Leonor Fini expose pour la première fois à l’âge précoce de 17 ans dans une galerie de Trieste en Italie. D’origine argentine et italienne, elle déménage à Paris en 1931, âge d’or du mouvement surréaliste. Elle se lie à plusieurs de ses artistes, notamment George Bataille, Paul Eluard, Max Jacob ou encore Max Ernst, sans pour autant s’affilier au mouvement. Artiste avant d’être muse, elle inspire à Paul Eluard et Constantin Jelenski des poèmes et des essais. Ses peintures montrent un penchant évident pour le merveilleux et l’ésotérisme. Elle dit peindre ce qu’elle voudrait voir : des corps nus représentés dans des scènes suggestives qui sous entendent une sexualité fluide, hors de toute contrainte sociale. Un de ses lieux de vie, un ancien monastère franciscain en ruine à flanc de mer sur l’île de beauté, la Corse, est à l’image de ce décalage avec les normes sociales. Elle y organisait notamment des fêtes costumées durant lesquelles chaque invité·e pouvait passer d’un genre à l’autre. Elle défend cette fluidité en proclamant que « si les gens étaient libres, ils seraient tous androgynes ». Sensible aux costumes et aux apparats, elle travaille avec le théâtre et l’opéra, dans la création de décors et de costumes. Elle collabore notamment avec Albert Camus ou Jean Genet qui sont conquis par son univers énigmatique et éminemment pluriel.


Au delà de leur genre, ces artistes ont fait appel à des ressorts similaires pour contourner les embuches qui se dressaient systématiquement sur leur passage. En combinant l’écriture et la peinture, Etel Adan et Pélagie Gbaguidi racontent de nouveaux récits pluriels. Berthe Morisot et Carmen Herrera sont toutes deux des pionnières de leur courant respectif : l’impressionnisme et l’abstraction géométrique. Quant à Leonor Fini, son Autoportrait au Scorpion a récemment été vendu à New-York pour plus de 2 millions de dollars. Un record pour l’artiste, malheureusement décédée depuis 1996. Le marché de l’art attendrait-il que les femmes artistes disparaissent pour apprécier leur travail ?