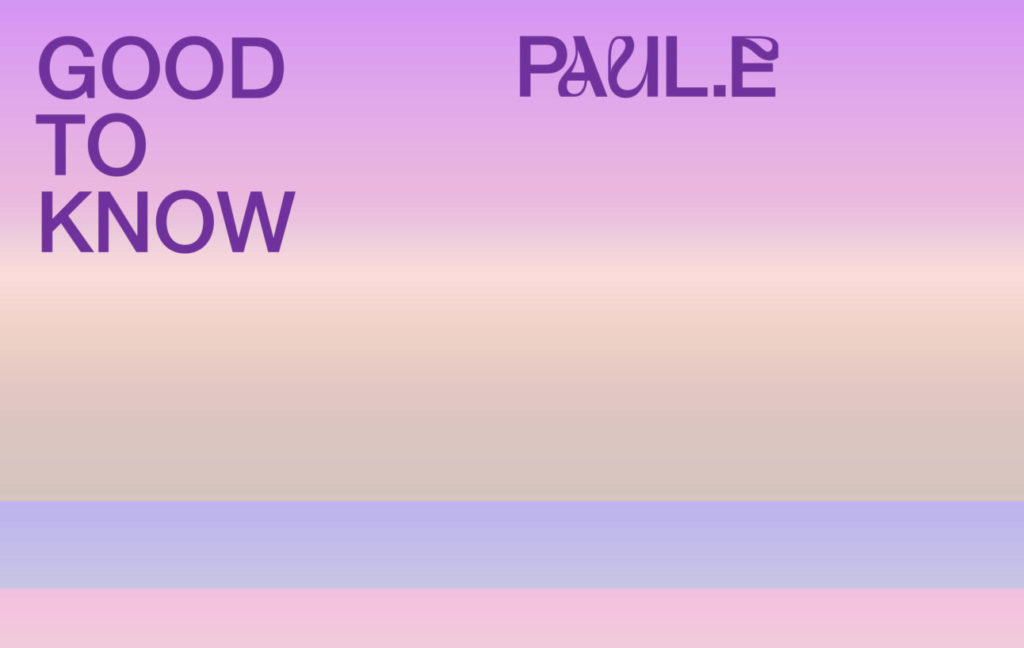AGY FAIT TOURNER LA RUE
Paris, triste vivier des sans-abri – dont le nombre ne fait qu’augmenter. Avec Agy, on se pose dans le fin fond du XVIIIe, ravies de se retrouver pour parler de La Rue Tourne, l’association qu’elle a cocréée pour lutter contre l’isolement de cette tranche de la population que la société a mise en marge. Parfois, quand le commun des mortels croise un.e sans-abri, il détourne le regard ou accélère le pas. Agy, elle, pose l’objectif de son appareil photo sur ces personnes et avec son équipe de maraudeur.ses, elle prend le temps de s’asseoir à leurs côtés pour « créer du lien social ». Elle s’intéresse vraiment aux gens et à leur histoire, qu’elle entreprend de mettre en lumière sur le site Internet et le compte Instagram de l’asso, ou lors d’expositions. C’est donc grâce à la photographie, aux réseaux et à son énergie communicative qu’Agy donne une visibilité à celles et ceux que la rue a rendu.es invisibles. Rencontre pour le moins poignante.

Comment conçois-tu le monde associatif?
Je suis quelqu’un d’assez rigide, alors je conçois l’associatif comme l’entreprise, notamment au niveau de l’organi- sation : je veux que les choses soient nickel, parce qu’au bout de la chaîne, c’est une personne sans-abri qui compte sur nous. Si un.e bénévole s’engage à donner un duvet par exemple, il faut que ce duvet soit donné dans les deux ou trois jours, pas des semaines après la demande. De manière générale, si on ne se fixe pas de deadlines et de contraintes, on vivote, on n’évolue pas.

D’où te vient ton engagement ?
J’ai toujours été attirée par les publics dits « fragiles ». Ça me passionnait d’aller interviewer des dealers au fin fond de Poissy et de comprendre comment ils en étaient arrivés là, d’essayer de déconstruire les parcours. Et c’est exactement ce que je fais au sein de l’asso La Rue Tourne. On a tendance à voir ce type de public comme des « sans » : sans abri, sans diplôme, sans compétences, sans qualifications, alors qu’en fait, il suffit de creuser un peu pour se rendre compte qu’ils.elles ont plein de « plus ». Il faut juste qu’ils.elles s’en aperçoivent pour capitaliser dessus. Souvent, il suffit d’une personne extérieure pour leur faire prendre conscience de leur talent, des qualités qu’ils.elles ont à faire valoir. Et ce n’est pas forcément évident, car ils.elles sont dans un environnement qui ne les met pas en lumière, surtout lorsqu’ils.elles ont dû, par exemple, vendre de la drogue. Mais il n’y a pas de déterminisme: les gens ne sont pas déterminés à rester sans abri ni à être décrocheurs.
Tu nous parles de La Rue Tourne ?
L’association a été créée en 2015 et s’articule autour de trois volets principaux. On fait de la maraude deux fois par mois. Pas vraiment alimentaire, car c’est quelque chose de très bien couvert sur Paris, mais avant tout pour créer du lien social : si une personne veut bien de nous, on se pose avec elle, on écoute la musique qu’elle kiffe, on parle de ses proches. On passe du temps avec elle, comme on le ferait avec nos potes – toute proportion gardée. Quand j’ai créé l’asso, j’étais dans une période de ma vie où je ne savais pas comment m’occuper, je faisais de la photo, mais ça n’avait pas trop de sens. J’étais seule et je voulais photographier la solitude. En marchant, comme ça dans la rue, le premier public que j’ai alors vu, c’est celui des sans-abri. Au début, je les prenais en photo d’assez loin, parfois je ne savais même pas quel était le visage de la personne, je ne connaissais pas son prénom, et elle ne savait pas que je la photographiais, donc ce n’était pas cool. Mon travail a pris du sens en devenant un outil pour ce public : je raconte les histoires des gens, en plus de leur tirer leur portrait. Les faire parler de leur vécu, c’est le meilleur moyen de sensibiliser. Puis on publie les récits et les photos sur les réseaux sociaux, sur notre site Internet. Je m’adapte à la volonté de la personne, bien sûr : par exemple, Saïd ne veut pas que je montre son visage, parce que sa famille n’est pas au courant, donc je respecte. C’est important, tout ça. Ce ne sont pas juste des sans-abri : c’est Thierry, c’est Saïd, c’est Ivo, c’est Kamir, c’est Sabine. Ce sont des gens, des individus. ils.elles avaient des carrières, des familles, ils.elles ont des rêves et des passions. Comme nous. La seule différence, c’est que nous, on a un toit au-dessus de la tête.

Tu as évoqué deux des trois volets de l’association : les maraudes et les portraits. Quel est le troisième ?
On fait de la sensibilisation. Bien sûr, pendant nos maraudes, on explique notre action aux gens qui nous observent, qui se questionnent sur ce qu’on est en train de faire, mais on fait aussi des interventions auprès des enfants dans les écoles. Un jour, on a décidé d’offrir un petit cadeau aux sans-abri. J’ai alors sollicité l’institutrice de la fille d’une amie pour fabriquer des cartes de vœux. Jusque-là, tout allait bien (Rires). Sauf que cette enseignante, engagée qu’elle était, Mme Le Maire, m’a demandé en contrepartie de la réalisation des cartes, de venir parler aux enfants de ce que je fai- sais avec La Rue Tourne. Des élèves du CP au CM2 ! Déjà, j’ai un sale rapport avec l’école, alors y remettre les pieds : l’angoisse. Rien que de revoir un préau, c’était compliqué (Rires) ! Deuxièmement, ce que je vois dans la rue, c’est autant positif que négatif. Comment parler à des primaires de la mort, de l’excision, de la drogue, de la prostitution ? Finalement, j’ai décidé de prendre l’axe positif de la solidarité. Je racontais aussi les histoires des sans-abri, mais sans entrer dans les détails. Je prenais un portrait et je demandais aux enfants : « À votre avis, quel est l’âge de cette personne ? Quel est son prénom ? D’où vient-elle et quel était son travail ? Depuis combien de temps est-elle dans la rue et pourquoi ? » Je déconstruisais les représen- tations en racontant les vraies histoires. Au début, j’étais un peu trop sans filtre… Aujourd’hui, j’ai trouvé le bon fonctionnement pour aborder ces sujets : je dis la vérité via un angle jovial et funky, tout en ne cachant pas la dureté de la rue. Les deux doivent cohabiter. Au final, les enfants ont plein d’idées, ils veulent faire plein de choses: à l’occasion d’un Noël, ils ont fabriqué des bougeoirs.
Tu dis que La Rue Tourne « crée du lien social », ça veut dire qu’elle « aide » ?

Pour moi, le vocable est très important. J’essaye d’employer le moins possible le mot « aider ». Parce que, quand on fait ce que La Rue Tourne réalise, on est déjà dans une relation de supériorité, qu’on le veuille ou non : on a beau le faire avec toute la bonne volonté du monde, on a un toit sur la tête, contrairement à celle ou celui qui est en face de nous. Pour moi, l’association, c’est du partage et pas de l’aide. Quand on maraude, on se met souvent à la place des sans-abri : si la personne est assise au sol, on se pose à côté d’elle. Il ne faut pas être dans une position condescendante. D’ailleurs, il n’y a rien de pire. Une fois, Christian pleurait et personne ne s’est arrêté. Bien sûr, c’est dur de se confronter à quelqu’un de triste, mais je trouve ça encore plus difficile qu’il n’ait pas reçu ne serait-ce qu’un peu d’attention. Et même parfois, on se prend des remarques : pourquoi est-ce qu’on fait ça, pourquoi est-ce qu’on entretient ce schéma social. Pardon, mais si les gens étaient contents d’être dans cette situation, ça se saurait ! Je distribue des cafés, pas des RSA !
Parle-nous de la réalité de la rue ; parle- nous des histoires qui t’ont le plus touchée.

Je pense à Kamir, cette femme qui a trois ans de moins que moi. Elle vit depuis dix ans dans la rue, du côté de Châtelet. Et on le sait, dans le centre de Paris, c’est là où se concentrent les trucs les plus dégueulasses : la drogue, la prostitution, la violence. Tout ça, elle l’a vécu. Elle s’est fait casser toutes ses dents de devant parce qu’elle a refusé un rapport sexuel. Elle s’est fait tirer par les cheveux jusqu’à en avoir une grosse cicatrice pour la même raison. Elle se fait régulièrement casser la gueule, soit par des gars de la street, soit par son copain qui sort de prison. Quand tu lui parles, tu as l’impression qu’elle a toujours 19 ans, car émotionnellement, ce n’est encore qu’une gamine. Son histoire me touche énormément. Son rêve, c’est de faire une formation en toilettage pour animaux. Mais elle vit dans un tunnel, elle fume du crack, elle se prostitue, probablement. En fait, je ne sais pas comment la sortir de cette situation. Elle est pourtant accompagnée, par les maraudes, une éducatrice spécialisée, une assistante sociale. C’est une histoire très difficile dont j’essaye de me distancier, car à un moment, ça m’a vraiment bouffée. Je suis même allée voir où elle habitait, dans le tunnel. Mais ça s’est mal terminé avec son copain. Puis il y a Pascal, un mec adorable décédé en 2015, à l’âge de 53 ans. Avant d’être dans la rue, il était conseiller bancaire en Lorraine. Il a perdu son travail après une embrouille avec son boss, sa femme l’a quitté. Il est alors venu chez un pote à Paris, qui est mort du sida. N’étant pas sur le bail du logement, il a dû partir et a fini sur le banc à Stalingrad, devant la Rotonde, pendant dix-sept ans. Un jour, la COP 21 a décidé de mettre des installations là où il était, alors la Mairie de Paris a fait le ménage. Et quand elle s’y emploie, elle ne demande pas aux gens de prendre leurs affaires et de partir. Elle apporte une benne et y jette tout – sacs de couchage, livres préférés. Pas le temps de niaiser. C’était début décembre, et Pascal a été retrouvé quelques jours après sous un parasol, mort d’hypothermie. À chaque sensibilisation, je parle de lui.
Tu es constamment confrontée à des histoires bouleversantes, injustes. Comment tiens-tu le coup ?

Je suis une véritable éponge émotionnelle, j’ai tendance à être hyper empathique. Je sais qu’il ne faut pas s’oublier, mais en même temps, je ne peux pas m’empêcher de penser aux sans-abri et à leurs besoins, qui doivent être comblés. Il y a deux semaines, j’étais fatiguée, et pourtant je suis allée récupérer la veste en cuir d’au moins 4 kg de Tyty, à Châtelet – il venait de la cirer deux fois pour qu’elle soit parfaite pour l’hiver, trop mignon ! – pour qu’il n’ait pas à se la traîner. Je l’ai déposée au local de La Rue Tourne, puis je suis retournée le voir pour lui fournir un kit d’hygiène. Je savais que c’était nécessaire, j’ai pris sur moi, car je savais très bien qu’après, de mon côté, j’allais rentrer chez moi, prendre une bonne douche et chiller devant Netflix. En fait, j’aime ce que je fais, c’est même devenu une passion.
Tu as parlé de Kamir. Les femmes bénéficient de conditions d’hébergement plus stables que les hommes, donc elles sont moins visibles dans la rue. En côtoies-tu ?
38 % des sans-abri sont des femmes. Certaines années, je n’en croise aucune. Les deux seules que je connais, ce sont Kamir et Sabine, proche de 50 ans. Toutes les deux ont de très forts caractères – elles n’ont pas le choix. Elles ont vécu les pires trucs. Être une femme dans la rue… Je n’ai même pas envie d’imaginer. Parfois, je retrouve Kamir avec un œil au beurre noir, j’ai envie de lui dire : « Mais barre-toi, Kamir, putain, barre- toi ! Qu’est-ce tu as à perdre ici ? » C’est étrangement confortable pour elle de rester dans son tunnel, c’est sa zone de confort. Elle n’a connu que ça en dix ans. Beaucoup de femmes se cachent, dans des tunnels, sous des ponts, dans des endroits peu fréquentés.
À cause de la honte ?
La honte, la violence, la peur de tomber sur le mauvais gars, peut-être bourré ou de mauvaise humeur, au mauvais moment. Parfois, j’ai l’impression que c’est plus compliqué d’être une femme dans la rue, mais ce n’est pas facile d’aller en interroger une sur sa vie, sur les causes, les raisons de sa situation. Trop personnel. Ça a l’air tellement plus sensible pour une femme que pour un homme. En tout cas, je ne lâche pas l’idée qu’un jour, je ferai une exposition de photos exclusivement de femmes.

As-tu déjà été confrontée à la précarité menstruelle ? C’est l’un de nos chevaux de bataille, chez Paulette.
Je suis contente que des médias se mobilisent. Ça fait un bail qu’on distribue des serviettes hygiéniques dans la rue. Après, dans mon secteur, les femmes n’ont souvent plus de règles à cause de la ménopause ou de leur cycle complètement flingué par ce qu’elles consomment. Personnellement, j’en distribue rarement, mais j’en ai toujours sur moi, au cas où. On en a plein au local et les autres groupes de maraudes les donnent régulièrement. Dans nos kits d’hygiène pour femmes, j’essaye d’ailleurs de remplacer les tampons par des serviettes : les femmes ont tendance à les garder trop longtemps. Les cups, c’est pareil: il faudrait qu’elles aient les mains propres pour la changer et de quoi la stériliser.
Tu es au cœur de l’action : quel est le bilan que tu dresserais de la situation actuelle de la rue?
Du côté des bénévoles, on voit que les gens veulent donner de plus en plus de sens à leur vie, en s’engageant notamment. La qualité de leur engagement est nettement supérieure qu’avant. Et le bilan sur le terrain, il est «bigoût». D’un côté, il y a de la solidarité, que ce soit grâce aux maraudes, mais aussi aux habitants qui prennent de plus en plus conscience de ce qui se passe autour d’eux, en bas de chez eux. En revanche, de 2001 à 2012, le nombre de personnes sans domicile a augmenté de 50 %. Ces sans-abri, ce sont des profils comme toi et moi, des gens qui ont fait des études, qui parlent plusieurs langues, qui ont des familles, des amis. Ivo, qui traîne avec Saïd, parle treize langues, il fait des tours de magie, des calculs improbables qu’il essaye d’ailleurs de m’apprendre, en vain. Saïd, lui, a bossé au Louvre, à la médiathèque de La Villette, il a toujours des trucs de ouf à raconter. Qu’est-ce qui a fait qu’il est dans la rue, depuis 18 ans ? Ce qui m’angoisse, c’est que ça peut vraiment arriver à n’importe qui. Mais cette peur est aussi un moteur, je me dis que je suis à la bonne place, même si parfois je suis fatiguée. Mais je me dis qu’il faut y aller. J’espère que ça ne m’arrivera jamais, mais si ça m’arrive, j’aimerais qu’on ait la même énergie pour moi.
Beaucoup souhaitent s’engager, mais ne savent pas trop par où commencer. Quels conseils donnerais-tu pour aider au mieux les personnes dans la rue ?

Certain.es, intuitivement, vont voir directement un.e sans-abri pour lui demander ce dont il ou elle a besoin. Ça va être un café, une bouteille d’eau, un sandwich, ou des choses très ponctuelles. Les gens n’abusent pas et ne vont pas te demander de faire un plein de courses. Ça, c’est une super démarche : il n’y a rien de mieux que d’aller aider la personne en bas de chez soi ou à côté de son bureau. Et quand vous ne savez pas trop, adressez-vous à une asso – la nôtre est plutôt cool (Rires). Vous comprendrez ainsi la dynamique, les besoins, les manières d’agir pour aider au mieux. Avec cette démarche où vous voyez un peu dans quoi vous mettez les pieds, vous pouvez rester et vous y investir. Le temps est un bien précieux, et moi, je préfère les gens qui viennent en maraude plutôt que celles et ceux qui font des dons, vraiment. Consacrer une après-midi de son temps, dans nos vies speed, ce n’est pas rien. Et venir avec ses compétences, c’est pas mal aussi! La Rue Tourne n’aurait pas le même impact si elle n’avait pas des bénévoles avec des compétences en graphisme, en web, ou encore en écriture.

Article du numéro 45 « Ensemble »
Article de Juliette Minel
Portraits réalisés par Agy