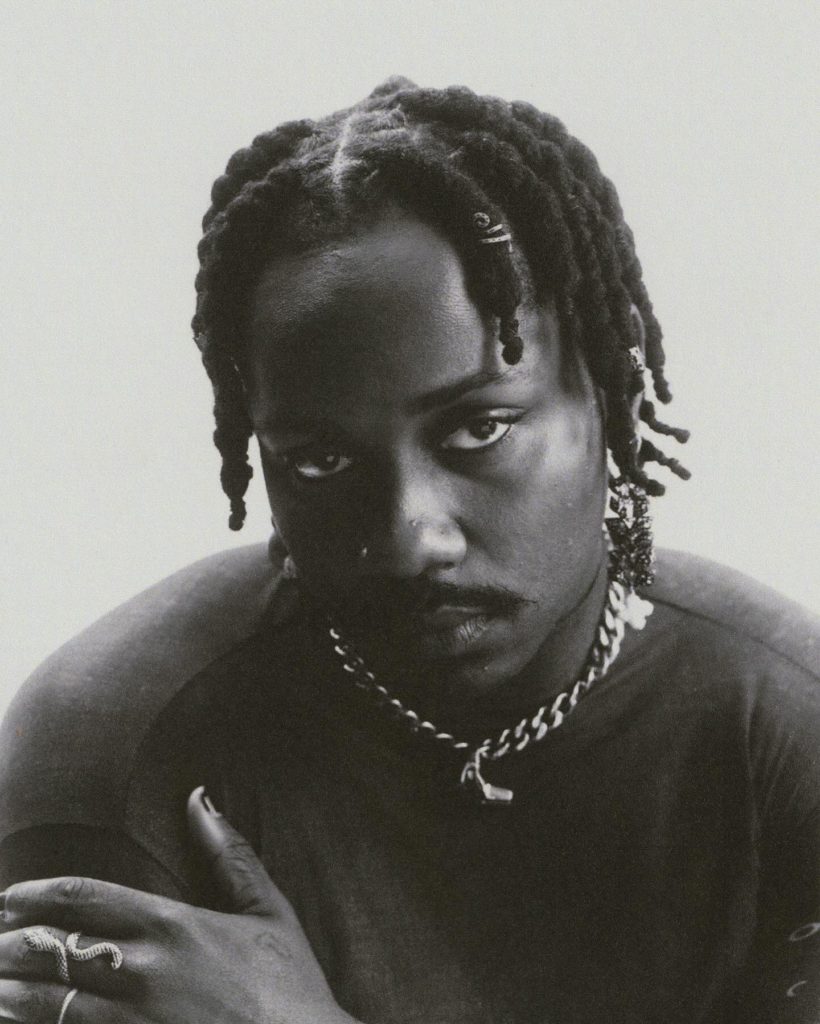CHARGE MENTALE, MA MALADIE DU BONHEUR

J’avais du mal à comprendre ce qui m’arrivait : l’euphorie du boulot, la vie perso, ma relation amoureuse et mes petits rebondissements quotidiens m’ont pourtant fait frôler le burn-out du bonheur. Des émotions, de l’adrénaline et des coups de jus qui m’ont amenée à « m’oublier ». Le tout, jusqu’à réaliser que j’en faisais trop, que je ne tiendrais pas et que j’avais finalement besoin d’aide. Charge mentale, deux mots que je comprends désormais et qui m’ont éduquée : il faut se préserver.
Je suis une boule de nerfs, une control-freak qui adore organiser, aider, papoter et gérer. Si je manque parfois de bons tuyaux pour hiérarchiser mes petits tracas, je m’occupe et me passionne de missions pour mon boulot ou de bonnes attentions envers les gens que j’aime. Je suis une grande accro à l’organisation d’événements et je me rends quotidiennement heureuse à la simple idée de pouvoir donner le sourire à mon entourage. Je gâte ceux qui m’importent, je me défonce au travail et je me laisse très rapidement envahir par la culpabilité dès que quelque chose cloche ou ne se déroule pas de la façon avec laquelle je l’aurais espéré. Il y a quelques temps, j’ai décidé de me marier. Il y a quelques temps, j’ai ressenti le besoin de déménager. Il y a quelques temps, ma vie a basculé et j’ai pensé pouvoir tenir la barre en me concentrant sur une to do list interminable variant entre travail, satisfaction personnelle et besoin de faire « plaisir » à autrui. Et si j’avais l’impression de nager dans le bonheur, je n’ai pas réalisé que j’étais entrain de me surcharger de manière démesurée – me dirigeant vers une porte que personne ne veut pousser. La surcharge mentale, soit une explosion de l’esprit traduite par un relâchement physique et psychique que l’on n’avait pas vue venir.
Comment ça se traduit ?
J’ai toujours été une grande dormeuse, du moins, il me fallait huit heures de sommeil pour être en forme. J’aime me lever tôt – toujours – mais je ne me couchais autrefois pas tard. Et là, qu’importe mon besoin enfoui de pioncer 16 heures : impossible de dormir ou de passer une soirée devant Netflix, impossible de cuisiner ou de simplement se détendre dans le canapé. Ma tête semblait me secouer du même mot : optimisation. Depuis plusieurs mois, voire maintenant un an, chaque heure doit faire l’objet d’un rendement, professionnel ou personnel. Le temps est chronométré, le Google Agenda ne cesse de chauffer. Des bêtises, des détails – récupérer 20 balles auprès de Numéricable en s’attaquant à leur service client me fait vibrer. Comme me lancer dans une veille d’outils digitaux à 3 du mat. Ah, et y’a les spritz avec les copines, qui permettent de maintenir le rythme avec une clope fine parce que je me répétais « tu l’as bien mérité ».
Et tout ça, je me l’imposais – aujourd’hui c’est fini. Personne ne m’a demandé de gérer ses problèmes, sa paperasse ou même ses petites affaires : je ne réalisais même plus que je ne prenais plus de temps pour moi et que mon entourage n’avait pas spécialement envie que je trempe mes pattes dans leurs agendas. Mes heures et mes journées libres étaient pour ma moitié, mes inquiétudes et mes doutes relevaient de mes relations amicales, amoureuses et professionnelles mais je ne prenais plus la moindre heure pour me SOIGNER. Du lundi au vendredi, je mangeais debout le midi – challengeant ma petite personne à remplir toutes les tâches imposées le matin au réveil.
J’ai tenu, j’ai failli mais j’ai vaincu
Et là, le monde commence à s’alerter : des petites réflexions type « tu ne t’arrêtes jamais ». Je sors trop, j’en fais des tonnes, je devrais parfois m’arrêter… Blablabla. Au début, c’était un compliment. Je me sentais puissante, invincible et en pleine forme. Je continuais le sport, je passais du temps avec mes proches, j’enchaînais les missions pros avec la banane : une croisière de meuf hyper-active en somme. Puis viennent les drôles de commentaires, les jeans autrefois trop justes qui deviennent en un clin d’oeil bien trop grands, les yeux qui pleurent à la fin de la journée et les poches qui s’accentuent sous les yeux bleus lorsqu’ils papillonnent au petit matin. La fatigue, les crises de larmes passagères, la peur de s’asseoir et le besoin constant d’être en mouvement : comme si ne rien faire quelques secondes m’empêcherait de dormir pendant les trois prochaines nuits.
Le corps lançait des SOS, mes règles ont disparu, les cheveux blancs se multipliaient et le moindre bruit anormal dans l’appartement entraînait le redressement de mes oreilles. Je me transformais en une efficace tour de contrôle, un chien de chasse et j’ai pourtant réussi à réaliser que, ouais, j’étais en train de me perdre. Il aura fallu une bonne grippe, un virus à la noix pour me clouer au lit après deux années de « Moi, je ne suis jamais malade car je prends soin de moi« . Une semaine de fièvre, de suées nocturnes et d’appels à l’aide pour qu’une amie de choix m’apporte des Doliprane et un peu de réconfort. L’impossibilité de travailler ou de réaliser le moindre effort. Désagréable, c’est sûr mais heureusement une grippe électrochoc. Elle n’est pas arrivée au hasard, elle veut me faire comprendre que je suis allée trop loin. Que je ne tiendrai plus, que je dois me retrouver si je veux sauver ma peau.
Alors lorsque je me sens un peu mieux, j’ouvre mes placards. Je cuisine à nouveau. Je mange puis j’ose monter sur la balance. Aoutch, j’ai vraiment maigri. Je secoue mes cheveux dans la salle de bain pour découvrir une montagne de pellicule, le stress certainement. Je tente d’appeler mes collègues, j’ai l’impression qu’ils n’ont pas vraiment besoin de moi. Il n’en est rien, ils ont simplement pour mission de me laisser me reposer. Mon entourage est inquiet, ils veulent que je ralentisse la cadence. Il n’est pas seulement question de boulot, bien au contraire, il s’agit ici d’une pression omniprésente – qui vient me ronger sans raison. Je me l’inflige tandis que je pourrais l’éviter. Les semaines qui suivent, je reprends confiance et me laisse un peu de temps. Je marche plus doucement, je m’allonge tôt le soir et retarde mon réveil le matin. Je me remplume, je souris. Je pige qu’il n’était pas question d’une dépression. Loin de là, on parle ici de charge mentale. La certitude qu’on doit accumuler les projets et les tracas du monde entier. Le sentiment de devoir rendre des comptes à chaque personne qui nous entoure, qu’on ne peut aller se coucher si tout est parfait.
Se plaindre tandis qu’on en est l’origine
Et pourtant, la route est longue. Cette crise peut paraître anodine, charge mentale ne parle à personne – on pourrait surnommer ça « le caprice d’une reine ». Il y a plus grave dans la vie car, non, il n’est pas question ici d’un diagnostic médical. Pas de compte à rebours ou de besoin de passer sur le billard, c’est un peu chercher les problèmes. On le répétera d’ailleurs à diverses reprises : personne n’a demandé à ce que l’on gère les soucis des autres au bureau ou à la maison. On n’est pas non plus en charge des missions pros de certains, ce n’est pas notre job. Pourquoi vider le lave-vaisselle chez ses potes alors qu’on ne déjeune même pas là-bas ? Et le pire, et voilà le vrai souci, c’est qu’on se retrouve dans une inondation de jobs sociaux jusqu’au point de s’en plaindre. « Personne ne me laisse tranquille », « j’ai reçu un mail à 23 heures« , « il m’a demandé d’aller lui acheter des clopes alors que j’ai bossé toute la journée et que je venais d’arriver« … Et on ne peut en vouloir qu’à soi-même car, au final, on a dit « Amen » dès que l’occasion s’est présentée. On a voulu garder le contrôle en répondant au téléphone non stop, en balançant des mails nocturnes jusqu’à voir culpabiliser son prochain puis, bien sûr, on est parti acheter de foutus cigarettes.
La bonne nouvelle
Sourions, le pire est passé dès lors que ces différents constats sont intégrés. Viennent dès lors le repos, l’envie de méditer, les mots doux comme les mots durs, les « non » répétitifs qui sont dans un premier temps incompris. Puis le sourire de la personne qu’on aime, les regards bienveillants de ses collègues et la possibilité de déconnecter complètement quand on en a besoin et que le calendrier le permet. La base, c’est aussi d’être bien entourée, de savoir que son entourage a compris. Une charge mentale, sans forcément être maman ou dans une difficulté particulière, c’est possible. Un burn-out de bonheur, ça arrive. Il faut juste savoir ralentir, s’offrir des bouffées d’air et accepter l’idée qu’on ne peut et qu’on ne doit pas tout contrôler. Et vous savez quoi ? On en dort mieux et on en tire une meilleure productivité !